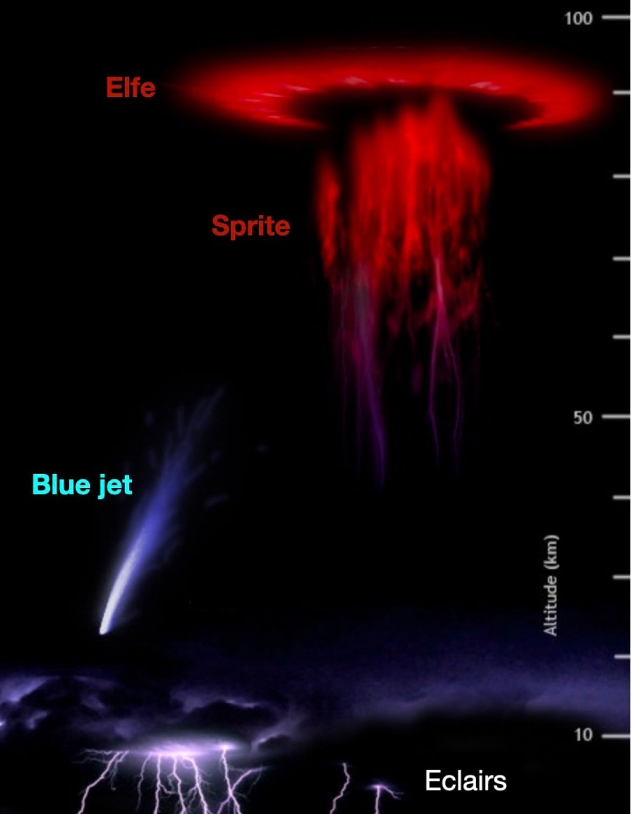Pionnière sur le plan scientifique, la mission Taranis est également remarquable par son organisation : il s’agit d’un programme essentiellement français développé entièrement sous maîtrise d’œuvre CNES. « Ce type de configuration devient très rare : nous contribuons régulièrement à des missions internationales en coopération, mais réaliser entièrement un satellite aussi abouti, cela constitue aujourd’hui l’exception », précise Kader Amsif, responsable du programme Soleil, héliosphère et magnétosphère du CNES.
Le satellite est né d’une collaboration étroite avec le Laboratoire et physique et chimie de l’environnement et de l’espace (LPC2E), situé à Orléans, qui a la responsabilité scientifique de la mission sous la direction de Jean-Louis Pinçon, et d’un partenariat avec 4 autres laboratoires français : IRAP, APC, CEA et LATMOS. « Il y a également des contributions d’instituts étrangers, pour l’essentiel par le biais de coopérations avec les laboratoires partenaires pour la fourniture d’éléments nécessaires aux instruments scientifiques : laboratoire Goddart Space Flight Center de la Nasa, université américaine Stanford, IAP et université de Prague, en République tchèque, Space Research Center de Varsovie, en Pologne », ajoute Christophe Bastien-Thiry, chef de projet Taranis au CNES.
Dialogue permanent entre le spatial et le scientifique
Depuis les premières phases du projet, en 2005, le développement du satellite a été rendu possible par les échanges permanents avec les partenaires scientifiques. Le CNES apporte l’ingénierie pour que la mission soit conforme aux objectifs scientifiques, mais cela demande tout au long du projet d’arbitrer entre ce qui est souhaitable d’un point de vue scientifique et ce qui est faisable du fait des contraintes du spatial.
Il y a une dimension humaine importante dans ce type de projet, un dialogue qui ne peut marcher que s’il y a du respect et de la crédibilité mutuelle entre nous. Ce climat de confiance a bien fonctionné sur Taranis.
Christophe Bastien-Thiry, chef de projet Taranis au CNES
Coopération en phase opérationnelle
La collaboration ne s’arrête pas avec le lancement, elle se poursuivra pendant toute la mission, prévue pour durer de 2 à 4 ans. Le CNES assurera le guidage et le pilotage du satellite en fonction des plans de programmation des instruments transmis par le centre de mission situé au LPC2E d’Orléans. « Notre préoccupation est de nous assurer que le système fonctionne et que les scientifiques reçoivent bien les données acquises », explique Christophe Bastien-Thiry. Celles-ci seront recueillies et traitées par le LPC2E, puis mises à la disposition des partenaires qui ont contribué au programme, avant d’être diffusées à l’ensemble de la communauté scientifique.